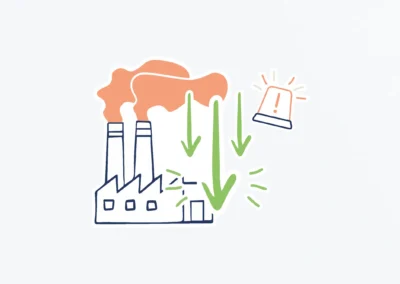Production hydrogène : comment ça fonctionne ?
L’hydrogène peut-il être un vecteur de la transition énergétique ? Oui, mais à certaines conditions, au niveau de sa production. Tour d’horizon des différentes technologies de production de l’hydrogène, et de leurs codes couleur associés.
Je souhaite décarboner mon industrie
Sommaire
1. L’hydrogène carboné : la méthode la plus répandue
2. L’hydrogène naturel, aujourd’hui encore le plus rare
3. L’hydrogène le plus vertueux : l’hydrogène carboné
4. Un modèle économique à trouver pour la production d’hydrogène décarboné
5. Quels usages prioritaires pour l’hydrogène décarboné ?
La méthode de production d’hydrogène la plus répandue : l’hydrogène carboné
Le marché mondial de l’hydrogène représente environ 100 millions de tonnes produites par an selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). Problème, la production d’hydrogène repose à une écrasante majorité sur des combustibles fossiles. Conséquence directe, les procédés techniques de production d’hydrogène sont émetteurs de CO2. Ce qui est logique : d’un point de vue physique, les combustibles fossiles sont des hydrocarbures. Schématiquement, ils sont donc composés d’hydrogène et de carbone. En séparant les molécules, on obtient du dihydrogène (H2) que l’on appelle communément « hydrogène », mais on laisse échapper le carbone qui, s’il est recomposé avec l’oxygène de l’air, forme du CO2. Voilà pour la partie chimique.
Environ 99%
La part de l’hydrogène carboné dans la production mondiale totale en 2024
Source : AIE
Il existe deux grands procédés techniques de production d’hydrogène à partir de combustibles fossiles :
- Le plus répandu est le vaporeformage (également appelé reformage à la vapeur) de gaz naturel. On parle dans ce cas d’hydrogène gris. Cette technologie est utilisée pour environ 60% des volumes produits dans le monde.
- Il est également possible de produire de l’hydrogène par gazéification du charbon. On parle cette fois d’hydrogène marron/brun (s’il est produit à partir de charbon) ou d’hydrogène noir (issu de lignite). Cette technologie représente environ 20% des volumes produits chaque année au niveau mondial.
Enfin, le solde des volumes produits mondialement (environ 20%) provient de sous-produits, c’est-à-dire d’hydrogène produit lors d’un processus industriel dont la fonction principale n’est pas de produire cet hydrogène.
Pour devenir un vecteur utile de la transition énergétique, la production d’hydrogène ne doit pas émettre de CO2. Bonne nouvelle, si les volumes produits sont très limités, les technologies existent et ne demandent qu’à être déployées à échelle industrielle.
Le plus rare : l’hydrogène naturel
On parle d’hydrogène blanc (ou hydrogène naturel) pour de l’hydrogène extrait dans le sous-sol sous sa forme naturel, mais à l’heure actuelle un seul site de production d’hydrogène blanc existe dans le Monde, au Mali. La France a reconnu en 2022 l’hydrogène blanc comme une ressource naturelle dans le code minier. Fin 2023, les pouvoirs publics ont pour la première fois autorisé des recherches de réserves d’hydrogène blanc dans les Pyrénées-Atlantiques. Enfin, en juin 2025, l’IFP Energies Nouvelles a remis aux pouvoirs publics un rapport dressant un état des connaissances sur l’hydrogène naturel. D’après l’institut, la France dispose d’un potentiel en hydrogène blanc avéré dans le Bassin aquitain, le Piémont pyrénéen ou le bassin houiller Lorrain, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie … sans toutefois en estimer les volumes potentiels à ce stade.
Le plus vertueux : l’hydrogène décarboné
Trois technologies permettent de produire de l’hydrogène sans émettre de CO2 :
- L’hydrogène bleu est produit à partir de gaz naturel (donc issu d’hydrogène gris à ce stade) mais avec un dispositif de capture et de stockage de carbone (carbon, capture, utilization and storage, CCUS, en anglais). Pour être complet, l’hydrogène turquoise – encore plus confidentiel – est lui produit par séparation chimique de combustibles fossiles et produit du carbone solide, qui ne va donc pas être émis dans l’atmosphère.
- L’hydrogène vert est produit par électrolyse de l’eau. Dans ce cas, un électrolyseur va séparer les molécules de l’eau (H2O) pour créer du dihydrogène (H2) en ne rejetant que de l’oxygène. Dans le cas de la production d’hydrogène vert, l’électrolyseur est alimenté par une électricité issue de sources renouvelables (éolien terrestre, éolien offshore ou solaire photovoltaïque par exemple).
- L’hydrogène jaune également appelé hydrogène rose est lui aussi produit par électrolyse de l’eau mais dans ce cas, l’électrolyseur est alimenté par de l’électricité produite par des centrales nucléaires.
Pour l’année 2024, l’AIE estime que la production d’hydrogène mondiale à faible émission provenait à plus de 50% d’hydrogène bleu (issu de gaz naturel avec CCUS) et moins de 50% d’hydrogène vert (par électrolyse alimentée par de l’électricité renouvelable).
1 million de tonnes
La production mondiale estimée d’hydrogène à faible émission en 2024 (+50% par rapport à 2021)
Source : AIE
Un modèle économique à trouver pour la production d’hydrogène décarboné
Des progrès peuvent bien sûr survenir, mais globalement, les procédés techniques actuels sont maîtrisés. Le principal obstacle au développement de l’hydrogène décarboné n’est pas technologique, mais bien économique.
Bien sûr, les coûts de production de l’hydrogène gris dépendent directement des prix du gaz naturel (qui peut être très volatil sur les marchés de gros comme en témoigne l’explosion des prix survenue en Europe en 2022) et, du niveau de taxation du CO2 (sur le marché européen du carbone EU-ETS par exemple). Le coût de production d’hydrogène bleu dépend lui aussi directement des prix du gaz mais également du coût des technologies de CCUS. Enfin, les coûts de production de l’hydrogène vert ou jaune varient respectivement en fonction du coût de production des énergies renouvelables et de l’électricité nucléaire. Mais il peut encore survenir un facteur 2 voire 3 entre le coût de production d’hydrogène gris et celui de l’hydrogène vert par exemple … ce qui pose la question des subventions à la filière décarbonée pour lui permettre de décoller.
Justement, la France a mis à jour en avril 2025 sa stratégie nationale hydrogène dite « SNH II » dont voici les principaux enseignements à retenir :
- Les objectifs d’installation de capacités d’électrolyse ont été revus à la baisse jusqu’à 4,5 GW en 2030 et 8 GW installés en 2025 (contre respectivement 6,5 GW en 2030 et 10 GW en 2035 prévus dans la première version de la stratégie nationale hydrogène « SNH I »).
- Un mécanisme de soutien à la production d’hydrogène bas-carbone doté de 4 milliards d’euros sur 15 ans.
- La relance de l’appel à projets « Briques technologiques de l’hydrogène IDH2 » porté par l’ADEME.
Pour le moment, la filière de production française d’hydrogène par électrolyse n’a toutefois pas réellement décollé comme en témoigne la capacité installée de 35 MW fin 2024 (contre 30 MW à fin 2023).
Je souhaite mettre en place un Energy Management System !
Quels usages prioritaires pour l’hydrogène décarboné ?
Même si la production d’hydrogène décarboné tente de monter en puissance, les volumes restent encore très limités. Se pose alors directement la question des usages prioritaires alors que l’hydrogène peut être utilisé comme combustible dans l’industrie, dans les transports routiers ou encore sous forme de produits dérivés dans le transport maritime et aérien (on parle ici de carburant d’aviation durables, CAD ou plus souvent de sustainable aviation fuel, SAF en anglais).
Deux cibles prioritaires, au moins à court terme, semblent toutefois émerger :
- Le remplacement de l’hydrogène carboné actuellement utilisé dans certains process de production industriels (fabrication d’ammoniac pour les engrais, raffinage de produits pétroliers, etc.) par de l’hydrogène décarboné.
- Le remplacement de combustibles fossiles utilisés dans l’industrie par de l’hydrogène décarboné, notamment pour les process industriels pour lesquels l’électricité – y compris décarbonée – n’est pas éligible comme vecteur énergétique.